
Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Le soir, ce n’est pas la cuisine qui me fatigue le plus. C’est la question qui arrive avant. Qu’est ce qu’on mange ce soir.
Elle revient tous les jours. Même quand le frigo est plein. Même quand j’aime cuisiner. Même quand, en théorie, tout pourrait bien se passer. Après une journée déjà chargée, devoir encore décider du repas devient une tâche de trop.
Pendant longtemps, j’ai cru que le problème venait de mon organisation. Je me disais que si je planifiais mieux, si je faisais des menus plus clairs, si je cuisinais davantage à l’avance, tout serait plus simple. En réalité, la fatigue restait. Parce que le vrai poids n’était pas dans la cuisson, mais dans l’accumulation des décisions.
Penser aux repas demande de l’énergie mentale. Anticiper. Adapter. Ajuster selon l’heure, l’humeur, le niveau de fatigue, les contraintes du jour. Et cette charge là est invisible. Personne ne la voit. Pourtant, elle revient sans pause, tous les soirs.
Je pensais que la fatigue liée aux repas venait surtout du temps passé aux fourneaux. En réalité, je me suis rendu compte que l’épuisement arrive bien avant d’éplucher le moindre légume.
La charge mentale commence au moment où je pense au repas. Quand j’essaie d’anticiper. Quand je me demande si j’ai ce qu’il faut. Quand je calcule le temps disponible. Quand j’adapte en fonction de l’énergie du jour. Tout ça se passe dans la tête, souvent en arrière plan, sans que je m’en rende vraiment compte.
Décider fatigue plus que faire. C’est une phrase qui m’a longtemps semblée abstraite, jusqu’au jour où j’ai compris qu’elle s’appliquait parfaitement aux repas. Cuisiner peut être agréable. Choisir, en revanche, devient vite lourd quand il faut le faire tous les jours.
Le repas n’est jamais vraiment terminé. Même quand je viens de manger, la question du prochain dîner n’est jamais très loin. Elle revient le lendemain. Puis le jour d’après.
Petit à petit, j’ai compris que ce n’était pas un manque d’envie ni un problème de motivation. C’était simplement trop de décisions à prendre, trop souvent, dans des moments où mon énergie est déjà entamée.

La question du repas ne se pose jamais quand j’ai l’esprit libre. Elle arrive le soir, quand la journée est déjà derrière moi, quand l’énergie a été utilisée ailleurs, quand la patience est plus ténue.
Même les jours où tout s’est bien passé, ce moment là demande encore un effort. Je dois décider alors que je n’ai plus vraiment envie de le faire. Et c’est sans doute pour ça que la fatigue est si marquée. Pas parce que la décision est compliquée, mais parce qu’elle arrive trop tard dans la journée.
Aimer cuisiner ne change pas grand chose à cette réalité. J’aime préparer des plats. J’aime manger quelque chose de bon. Mais aimer cuisiner ne signifie pas avoir envie de décider tous les soirs. La répétition finit par user, même quand l’activité en elle même est plaisante.
Il y a aussi une forme de pression silencieuse. Manger équilibré. Ne pas refaire toujours la même chose. Faire plaisir. Ne pas perdre trop de temps. Adapter au niveau de faim. Tout ça se mélange au moment où je suis le moins disponible mentalement.
Le problème ne venait pas d’un manque de bonne volonté. Il venait du timing. La question du repas arrive quand je suis la moins armée pour y répondre calmement.
Le nombre de décisions que je prends autour des repas sans même m’en rendre compte. Elles ne sont jamais spectaculaires, mais elles s’accumulent.
Il y a d’abord la question évidente. Qu’est ce qu’on mange. Puis viennent toutes celles qui suivent presque automatiquement. Est ce que j’ai les ingrédients. Est ce que ça va prendre longtemps. Est ce que j’ai l’énergie pour cuisiner ou est ce qu’il faut quelque chose de plus simple. Est ce que ça va suffire. Est ce que j’ai envie de ça, là, maintenant.
Même quand je choisis un plat très basique, le cerveau travaille. J’anticipe. J’ajuste. Je renonce parfois à une idée pour en choisir une autre, plus rapide, plus simple, plus adaptée au moment. Tout ça se fait en quelques secondes, mais ça mobilise de l’énergie.
Ce qui rend ces décisions si fatigantes, c’est qu’elles sont constantes. Elles reviennent tous les jours. Elles ne se stockent pas. La décision prise aujourd’hui ne sert pas demain. Je recommence, encore et encore, sans jamais vraiment avoir l’impression d’en finir.
Mettre des mots sur ces décisions invisibles m’a aidée à comprendre que ma fatigue n’était pas exagérée. Elle était simplement le résultat d’une accumulation silencieuse, que je n’avais jamais vraiment prise au sérieux.
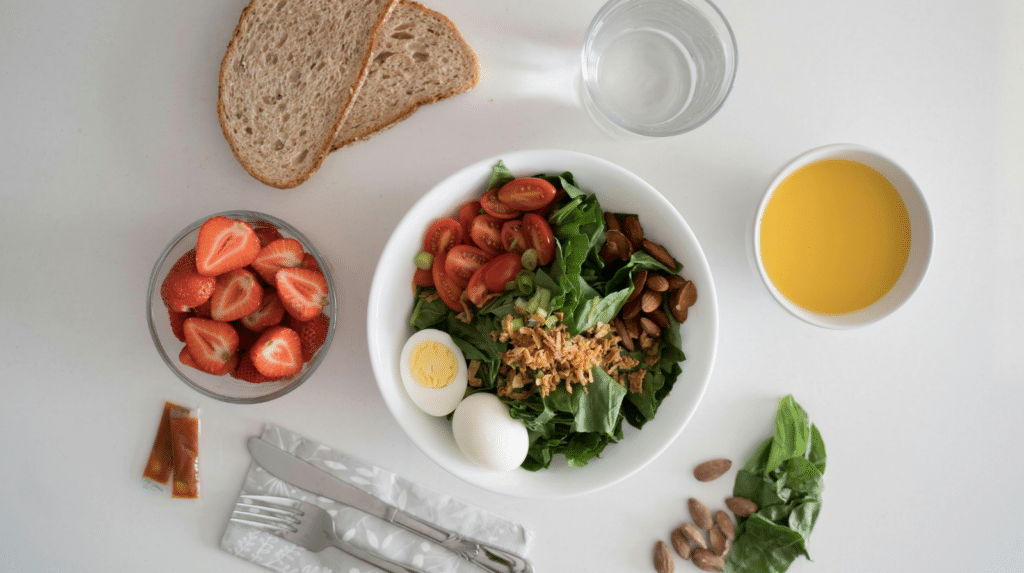
Je n’ai pas réalisé tout de suite que la charge mentale des repas avait débordé. Ce n’est pas arrivé d’un coup. C’est venu par petites touches, presque discrètement.
J’ai commencé par refaire souvent les mêmes plats. Pas par envie, mais par facilité. Des repas qui demandent peu de réflexion, peu d’ingrédients, peu de décisions. Ensuite, j’ai senti une forme d’agacement. Pas forcément contre la cuisine, mais contre la question elle même. Le simple fait d’y penser me fatiguait.
Il y a eu aussi ces soirs où je repoussais le moment de décider. Je traînais un peu plus. Je faisais autre chose. Comme si retarder la décision allait la faire disparaître. Évidemment, elle revenait toujours, mais avec encore moins d’énergie disponible.
À certains moments, j’ai même perdu le plaisir de manger. Le repas devenait une contrainte à gérer, une tâche à cocher, pas un moment agréable. Et quand ça arrive, ce n’est pas un problème de motivation ou de discipline. C’est un signal.
Avec le recul, je comprends que cette fatigue n’était pas un échec personnel. C’était simplement le signe que le système ne fonctionnait plus. Trop de décisions. Trop souvent. Sans pause possible.
Reconnaître ce débordement a été une étape importante. Ça m’a permis d’arrêter de me juger, et surtout de chercher autre chose que des solutions parfaites.
Pendant longtemps, j’ai pensé que le problème venait surtout d’un manque d’organisation. Je me disais que si je planifiais mieux, si je faisais des menus à l’avance, si je m’y prenais plus sérieusement, la fatigue disparaîtrait.
J’ai essayé de prévoir les repas pour la semaine. J’ai fait des listes. J’ai même cuisiné à l’avance certaines périodes. Sur le papier, tout semblait fonctionner. Dans la réalité, l’épuisement revenait très vite. Pas toujours au même moment, mais toujours de la même manière.
Je me suis aussi dit que cuisiner davantage réglerait le problème. Puisque j’aime ça, autant m’y mettre plus souvent. Là encore, l’idée était séduisante. En pratique, aimer cuisiner ne supprime pas la répétition ni la contrainte quotidienne de décider. Même un plat préparé avec plaisir demande une décision au départ.
Avec le recul, je comprends mieux pourquoi ces solutions n’ont pas tenu. Elles ajoutaient souvent une couche supplémentaire. Plus d’anticipation. Plus de planification. Plus de choses à penser en amont. Elles cherchaient à optimiser, alors que mon problème venait surtout d’un trop plein.
À force, j’ai compris que je n’avais pas besoin de mieux faire. J’avais besoin de faire moins, surtout moins de choix à prendre chaque jour. Tant que je cherchais la méthode parfaite, je passais à côté de l’essentiel.

Le vrai déclic n’est pas venu d’une meilleure organisation. Il est venu du moment où j’ai arrêté de chercher la méthode idéale. Celle qui fonctionnerait tout le temps, quelles que soient la fatigue, la semaine, ou l’humeur.
J’ai commencé à regarder les repas autrement. Non plus comme quelque chose à optimiser, mais comme quelque chose à rendre supportable. J’ai compris que ce qui me soulageait le plus, ce n’était pas de gagner dix minutes en cuisine, mais d’enlever des décisions.
Ne plus décider tous les soirs. Ne plus me demander si je fais bien. Ne plus chercher l’équilibre parfait à chaque repas. Accepter que certaines semaines soient très simples, répétitives, presque mécaniques, et que ce soit parfaitement ok.
J’ai aussi arrêté de vouloir une seule façon de faire. J’alterne désormais. Certaines semaines, j’anticipe un peu. D’autres, je simplifie au maximum. Et parfois, je délègue complètement. Pas par faiblesse, mais par lucidité. Parce que mon énergie n’est pas constante, et que mes repas n’ont pas besoin de l’être non plus.
Ce changement là a été plus efficace que toutes les méthodes testées avant. En retirant de la pression, j’ai retrouvé du calme. Les repas ont cessé d’être un sujet permanent dans ma tête. Ils ont repris leur place, importante mais pas envahissante.
Avec le temps, j’ai compris que tous les outils ne se valent pas. Certains donnent l’impression d’aider, mais ajoutent en réalité une couche de réflexion en plus. D’autres enlèvent vraiment du poids, parce qu’ils suppriment des décisions plutôt que d’en déplacer.
Les box à cuisiner déjà pensées font partie de ceux qui m’aident le plus. Ne pas avoir à imaginer un plat, ni à vérifier si les ingrédients vont ensemble, enlève déjà une bonne partie de la charge. Même si je cuisine ensuite, le fait que quelqu’un ait fait ce travail en amont change complètement mon rapport au repas.
Le fait d’avoir des ingrédients déjà décidés joue aussi beaucoup. Quand je sais que tout est là, dans les bonnes quantités, je ne me pose plus la question de savoir si j’ai oublié quelque chose. Je ne fais pas d’arbitrage en dernière minute. Je passe directement à l’action, ou je décide de reporter sans culpabiliser.
La répétition assumée m’aide plus que je ne l’aurais cru. Refaire souvent les mêmes plats, ou tourner sur un petit nombre d’options, enlève énormément de charge mentale. Pendant longtemps, j’ai cru qu’il fallait varier pour bien faire. Aujourd’hui, je préfère la simplicité. Mieux vaut un repas connu et serein qu’une nouveauté imposée un soir de fatigue.
Il y a aussi les solutions temporaires. Celles que je n’utilise pas tout le temps, mais qui me sauvent certaines semaines. Déléguer ponctuellement. Simplifier radicalement. Accepter un repas très basique sans me juger. Ces options ne sont pas des renoncements. Elles sont des ajustements.
Réduire la charge mentale passe rarement par plus d’efforts. Ça passe par moins de décisions. Et surtout par le droit de changer de stratégie selon les périodes, sans chercher à être cohérente en permanence.
Aujourd’hui, je n’ai plus une seule façon de gérer les repas. J’ai un ensemble de réflexes que j’adapte selon les semaines, mon niveau de fatigue et ce que j’ai envie de mettre dans mes soirées.
Certaines semaines, tout est très simple. Je tourne avec quelques repas que je connais par cœur. Je ne cherche pas à varier. Je sais que ça fonctionne, que ça me demandera peu d’énergie, et que je mangerai correctement sans y penser. Ces périodes là sont souvent celles où j’ai le plus besoin de calme.
D’autres semaines, j’ai un peu plus de disponibilité. J’ai envie de cuisiner, de prendre le temps, de retrouver un certain plaisir dans la préparation. Je choisis alors des recettes qui demandent un peu plus d’implication, sans pour autant me lancer dans quelque chose de trop ambitieux.
Et puis il y a les semaines vraiment chargées. Celles où je sais d’avance que je n’aurai ni l’envie ni l’énergie de décider. Dans ces moments là, je m’autorise à déléguer. Pas en me disant que je fais moins bien, mais en acceptant que ce soit la solution la plus tenable à ce moment précis.
Ce fonctionnement m’a enlevé beaucoup de pression. Je ne cherche plus à être régulière. Je cherche à être en phase avec ce que je peux vraiment faire. Les repas ont cessé d’être une source de tension permanente. Ils sont redevenus un élément de mon quotidien, important mais à leur juste place.
Si cette fatigue liée aux repas vous parle, c’est souvent qu’elle s’inscrit dans une réflexion plus large autour de l’organisation du quotidien et des solutions possibles pour manger plus sereinement en semaine. J’ai exploré ces pistes dans d’autres articles: